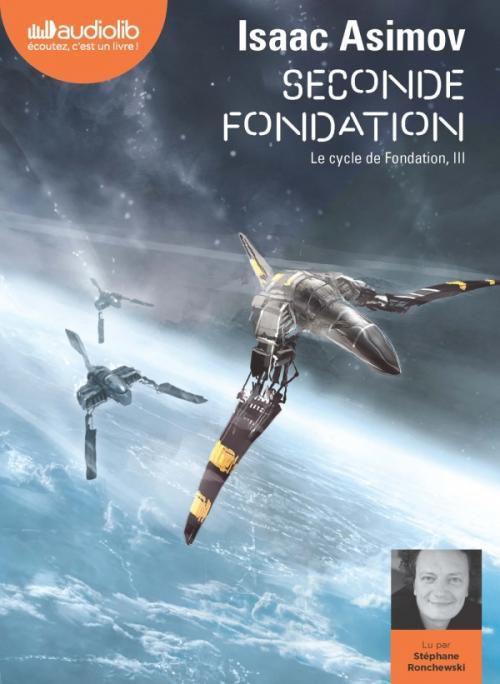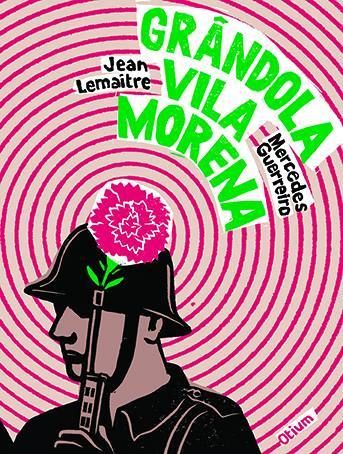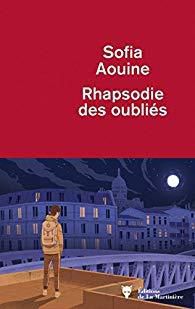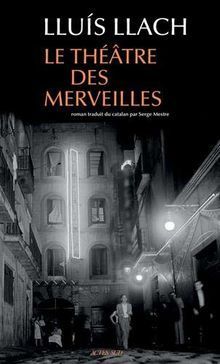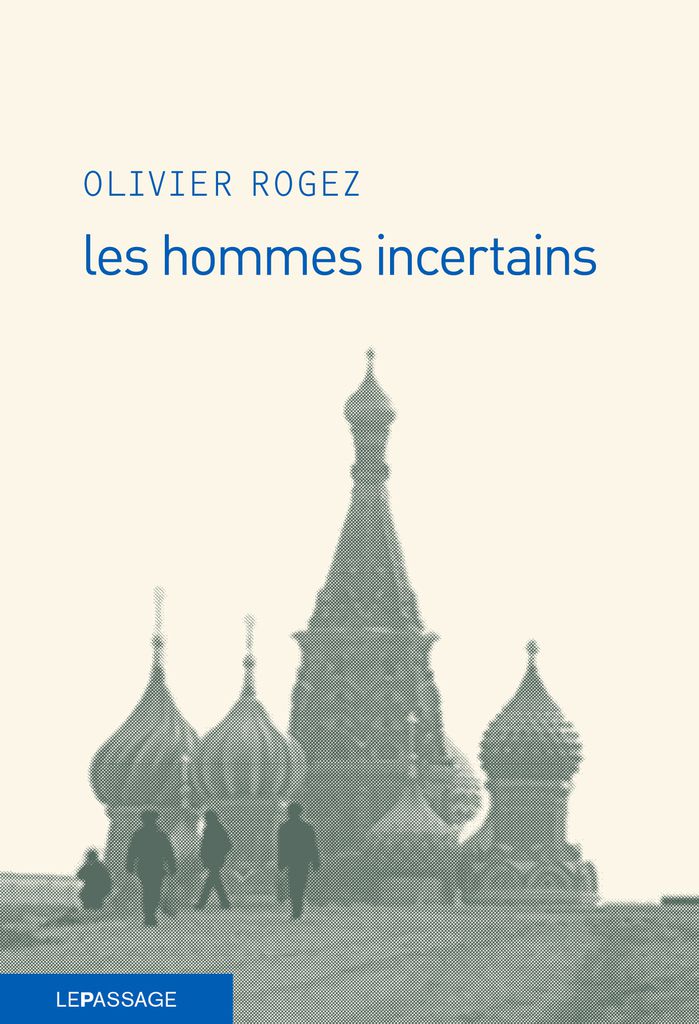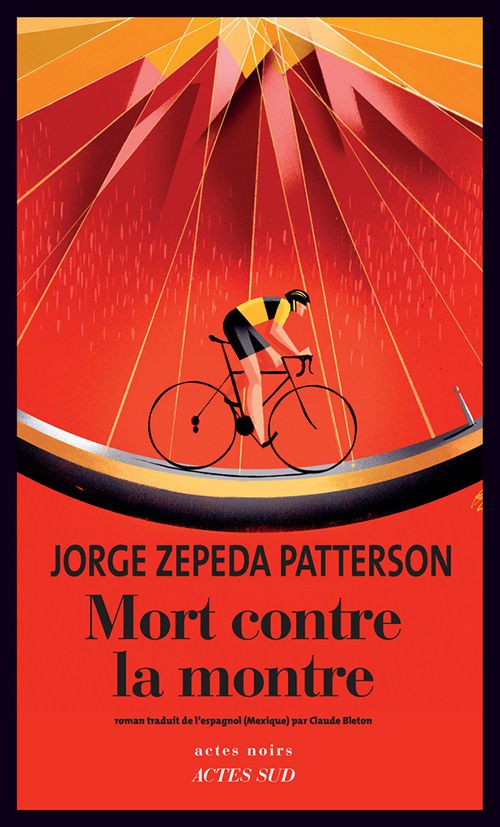Réfugiée, Hannah Arendt le fut et le raconte, l’analyse et nous surprend par la conclusion qu’elle apporte à sa réflexion. Elle s’y adonne au nom de tous ceux qui ont été contraints de fuir leur pays d’origine. Au nom de tous ceux qui ont été contraints d’opter pour un nouveau départ. Ailleurs. Et par optimisme. Au nom de ceux qui ont tout quitté par optimisme. Confiance en l’être humain : ailleurs, nécessairement, les hommes devraient pouvoir s’entendre, non ? Mais elle raconte surtout ce qu’il en coûte d’abandonner la familiarité de la vie quotidienne. Ce qu’il en coûte de perdre son environnement, ses proches, ses amis, son travail, mesurant ligne après ligne ce qu’il lui en a coûté d’émigrer. Perdre sa langue, c’est-à-dire le «naturel» de ses réactions, «la simplicité de ses gestes». Avec au bout parfois pas même l’espoir de trouver sa juste place dans la société d’accueil. En outre, en arrivant sur le sol qui l’hébergeait, elle dut accepter l’énorme sacrifice qu’on exigea d’elle : celui d’oublier. Jusqu’à «ces histoires de camps», trop culpabilisantes pour qu’on tolérât leur rappel. Comme tant d’autres, exister ailleurs commandait d’oublier. De retrancher. Pour construire cet avenir incertain que le monde avait à proposer. Retrancher et arborer sa reconnaissance. Un devoir moral. Et Hannah Arendt de démontrer combien cet impératif d’optimisme est dangereux : nombre de réfugiés y succombent, aboutés qu’ils sont à leur fragilité que le devoir d’optimisme ne peut tolérer. De sorte que ne s’offre aux réfugiés, la plupart du temps, qu’une liberté négative : non seulement le réfugié doit se battre nuit et jour pour s’arracher au flot des vagabonds, mais, sommé jour après jour de justifier son existence dans le pays d’accueil, il doit lui manifester sa soumission, en réalité, plutôt que son adhésion. Et Hannah Arendt de rappeler son expérience du camp français de Gurs, où elle fut un temps enfermée, sommée d’accepter d’y vivre comme «prisonnière volontaire», soumise aux caprices d’une administration délirante. Gurs… Les premiers prisonniers volontaires de l’Histoire contemporaine... Emprisonnée parce que juive allemande… Des réfugiés, nous dit Hannah Arendt, on attend qu’ils renoncent à leur identité. Ils ne le doivent pas, affirme-t-elle : ils sont l’avant-garde d’une possible souveraineté de l’humanité. Qu’ils conservent plutôt cette identité plutôt qu’il ne l’aplanisse sous les artifices de la loyauté : c’est autant le pays hôte qu’eux-mêmes qu’ils enrichiront.
Hannah Arendt, Nous autres réfugiés, Allia, janvier 2019, 44 pages, 3.10 euros, ean : 9791030410211.