 On se rappelle les propos de Hannah Arendt sur la banalité du Mal. Mais déjà moins la Palme d'or de 2009, attribuée à l'Autrichien Michael Haneke pour Le Ruban blanc.
On se rappelle les propos de Hannah Arendt sur la banalité du Mal. Mais déjà moins la Palme d'or de 2009, attribuée à l'Autrichien Michael Haneke pour Le Ruban blanc.
Un film dont tout le monde s’accordait à vanter la photographie somptueuse - en noir et blanc-, et la gravité du sujet : les dégâts de l’éducation autoritaire qui avait la faveur de la vieille Europe Réformée du début du XXe siècle. Education rigoriste, conforme à l’idéal culturel des pays protestants, si méfiants à l’égard de l’individu, voire à l’égard de la nature humaine tout court.
Rappelez-vous : il s’agissait d’un film sur la naissance de la terreur civique. Le film de Haneke, nous assurait Toubiana, le grand essayiste contemporain du cinéma, "(était) splendide, profond, filmé à la bonne distance". Mais à quoi tenait sa force ? A ce qu’il portait un regard implacable sur une conception de l’éducation qui n’était plus la nôtre ? Non, à l’universalité du sujet abordé, répondait Toubiana, à savoir : la question du Mal, "et comment il s’installe et se distille à travers les mailles les plus infimes d’une communauté villageoise allemande, à l’aube de la Première Guerre mondiale ".
Tous les poncifs resurgirent du coup, dès lors que l’on songeait au Mal sans en expliciter l’infortune : qu’il ne parvienne pas à s’élever au rang de substance et qu’il ne soit au fond justiciable que des seules catégories du Bien. Bien commode alors d’en supposer nos âmes pleines, indéfectiblement, pour éviter d’avoir à le dénoncer. Bien commode, parce que cela permettait l’amalgame : le mal était en nous, indubitablement, assurément partagé, peut-être le sentiment le mieux partagé au monde.
Rien n’a fondamentalement changé aujourd’hui, nous continuons de penser que le mal tient pleinement dans son évidence, alors qu’il est possible de le nommer, de le dénoncer plutôt que de le chérir vriller au fond des âmes, tapi dans quelque repli obscur d’une peur qui a, en réalité, beaucoup d’autres noms que celui du Mal.
Voilà qui n’est pas sans rappeler d’autres succès de l’époque, la nôtre, comme celui des Bienveillantes, explorant cette même prétendue banalité du Mal et autorisant tous les amalgames, puisque, au fond, le Mal est partout. Que cache donc cet expression de banalité du Mal, abusivement confisquée à Hanna Arendt ? De quoi nous parle-t-on quand on l’évoque ?
 Dans le film de Haneke, on ne voyait que cette "grande beauté plastique, (en) noir et blanc (déployant) toutes ses nuances et (faisant) de chaque image une gravure", comme l’écrivait Toubiana.
Dans le film de Haneke, on ne voyait que cette "grande beauté plastique, (en) noir et blanc (déployant) toutes ses nuances et (faisant) de chaque image une gravure", comme l’écrivait Toubiana.
Qu’est-ce qu’un beau film ?…
Peut-être ce que Mallarmé affirmait, désappointé : un pur jeu formel…
Dans le même festival on projetait Inglourious basterds, de Tarantino. L’Autrichien Christoph Waltz recevait le Prix d'interprétation masculine pour son rôle d’officier SS, dans un film dont on ne cessait de saluer la beauté. Mais là encore, de quoi parlait ce film, sinon de la virtuosité de son metteur en scène ?
Loin des rumeurs de Cannes et dans un autre registre, un livre m'est revenu en mémoire : La Peau du Loup, de Hans Lebert. J’ai gardé le souvenir de sa beauté formelle bien sûr, de l’intelligence de sa construction et de l’énigme à laquelle il ouvre, qui vous saisit et vous jette, lecteur, dans les affres d’un questionnement inévitablement personnel, vous engageant singulièrement dans votre lecture, ce pour quoi le verbe est fait.
Il s’agit toujours de l’Autriche, de l’héritage nazi, de la mémoire de ces événements que l’on veut reconstruire à l’usage des temps présents et des raisons qui nous y poussent. Car : que faisons-nous de ces beaux films, tout comme de ces romans si forts, si convaincants ?
 Didier Eribon, dans son dernier essai, évoque cet horizon que je pointe et qui se fait jour face à l'orientation que prend le mot de Culture dans nos sociétés néo-libérales. Il parle de la Culture comme d'une ruse suprême de la Domination. Une ruse qui impose sa faconde et son style. Le bon goût... Condition même de la culture, cette arme qui ne se définitit que dans le périmètre étroit édicté par la classe dominante. Il en parle comme d'une ruse imparable qui opère avec la complicité de ses cooptés, rejetant tout ce qui pourrait troubler son ordre esthétique, sélectionnant les oeuvres qu'il convient d'admirer dans les termes qui définissent son convenable en demeurant à tout jamais étrangers à toute vraie contestation artisitique. Didier Eribon rappelle Nizan, cette voix forte, réellement forte quand nombre d'artistes d'aujourd'hui ne font qu'y prétendent. La Bourgeoisie, affirmait Nizan, ne coïncide pas avec l'humain. Il nous faut, contre elle, inventer une autre manière d'être humain, une autre culture donc, construire des "temporalités inattendues". Et puisque nous écrivons encore dans la langue de l'ennemi, nous poser la question de savoir ce que cela change d'écrire dans sa langue notre radicale opposition à ce qui la fonde.
Didier Eribon, dans son dernier essai, évoque cet horizon que je pointe et qui se fait jour face à l'orientation que prend le mot de Culture dans nos sociétés néo-libérales. Il parle de la Culture comme d'une ruse suprême de la Domination. Une ruse qui impose sa faconde et son style. Le bon goût... Condition même de la culture, cette arme qui ne se définitit que dans le périmètre étroit édicté par la classe dominante. Il en parle comme d'une ruse imparable qui opère avec la complicité de ses cooptés, rejetant tout ce qui pourrait troubler son ordre esthétique, sélectionnant les oeuvres qu'il convient d'admirer dans les termes qui définissent son convenable en demeurant à tout jamais étrangers à toute vraie contestation artisitique. Didier Eribon rappelle Nizan, cette voix forte, réellement forte quand nombre d'artistes d'aujourd'hui ne font qu'y prétendent. La Bourgeoisie, affirmait Nizan, ne coïncide pas avec l'humain. Il nous faut, contre elle, inventer une autre manière d'être humain, une autre culture donc, construire des "temporalités inattendues". Et puisque nous écrivons encore dans la langue de l'ennemi, nous poser la question de savoir ce que cela change d'écrire dans sa langue notre radicale opposition à ce qui la fonde.
 Il y a donc un "travail de la culture" à faire face à cette survivance inavouée du nazisme, qui pointe déjà la faillitte d'une nation, la nôtre. Les meurtriers politiques ne tombent pas du ciel.
Il y a donc un "travail de la culture" à faire face à cette survivance inavouée du nazisme, qui pointe déjà la faillitte d'une nation, la nôtre. Les meurtriers politiques ne tombent pas du ciel.
Dans les propos officiels que l'on a entendu ici et là autour de la mort du jeune Clément, il y avait comme un refus d'affronter ce moment de transformation que cette mort pointe. A défaut d'en faire une crise, on a vu des politiques tenter d'en faire un spectacle (de rue, à Paris, pour ne désigner personne). Solennel. En bleu et blanc. Et rose. Mais ni les uns ni les autres n'ont cherché à scruter ce qui, dans leur propre camp, avait contribué à libérer ce Mal. Ce n'est pourtant qu'à cette condition qu'il sera possible d'éclairer le rapport au crime politique que la société française vient de prendre.
On aura vu ainsi les Médias inquiéter la victime, et la Droite s'enfermer dans le paradoxe philosophique de l'inhumaine humanité, excluant l'idée d'une quelconque responsabilité dans le Mal accompli.
On aura entendu encore répéter l'excuse du café du commerce : l'homme est un loup pour lui-même (Hobbes), et nos élites oublier la réponse de Spinoza à Hobbes : "Il n’y a rien de plus utile à l’homme que l’homme".
 On aura vu la Gauche se payer cette fois encore de vains mots dans l'oubli du sens profond de cette phrase : le défaut de secours que l'on voit se faire jour en France à l'égard des plus démunis, à l'égard des classes populaires, à l'égard des petits-enfants d'immigrés, à l'égard des précaires, à l'égard des salariés pauvres, à l'égard des retraités pauvres, à l'égard des enseignants démonétisés, des enseignés méprisés, etc., l'on pourrait démultiplier à l'infini, est la cause de ce Mal qui finira bientôt par révéler son nom sinistre.
On aura vu la Gauche se payer cette fois encore de vains mots dans l'oubli du sens profond de cette phrase : le défaut de secours que l'on voit se faire jour en France à l'égard des plus démunis, à l'égard des classes populaires, à l'égard des petits-enfants d'immigrés, à l'égard des précaires, à l'égard des salariés pauvres, à l'égard des retraités pauvres, à l'égard des enseignants démonétisés, des enseignés méprisés, etc., l'on pourrait démultiplier à l'infini, est la cause de ce Mal qui finira bientôt par révéler son nom sinistre.
La privation des besoins économiques élémentaires relève pourtant d'une décision politique qu'il n'est pas si difficile de prendre, alors qu'en refusant ce genre d'ambition, on crée les conditions d'une dévastation sauvage des sociétés humaines.
"Il n’y a rien de plus utile à l’homme que l’homme".
Sans ce souci, sans cette socialité séminale, il ne reste en effet que la violence pour seul dénominateur commun. Celle qui humilie, celle qui méprise, celle qui sépare et finit par tuer.
«Le fascisme nous gagne sans même que nous le sachions», écrivait Haneke il me semble. Un fascisme rampant du trop plein d‘amertume et de misère, de rancœur et de rancune qui pourraient bien tout emporter sur son passage.
image Leni Riefenstahl, self-portrait...
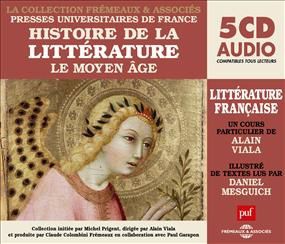 Un cours d’Alain Viala, passionnant, érudit, la Ballade des pendus pour ouvrir à cette superbe leçon de littérature, lue par Mesguich.
Un cours d’Alain Viala, passionnant, érudit, la Ballade des pendus pour ouvrir à cette superbe leçon de littérature, lue par Mesguich. 


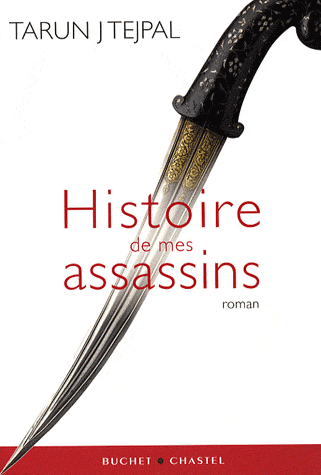 « Le fascisme nous gagne sans même que nous le sachions »
« Le fascisme nous gagne sans même que nous le sachions » On se rappelle les propos de Hannah Arendt sur la banalité du Mal. Mais déjà moins la Palme d'or de 2009, attribuée à l'Autrichien Michael Haneke pour Le Ruban blanc.
On se rappelle les propos de Hannah Arendt sur la banalité du Mal. Mais déjà moins la Palme d'or de 2009, attribuée à l'Autrichien Michael Haneke pour Le Ruban blanc. Dans le film de Haneke, on ne voyait que cette "grande beauté plastique, (en) noir et blanc (déployant) toutes ses nuances et (faisant) de chaque image une gravure", comme l’écrivait Toubiana.
Dans le film de Haneke, on ne voyait que cette "grande beauté plastique, (en) noir et blanc (déployant) toutes ses nuances et (faisant) de chaque image une gravure", comme l’écrivait Toubiana. Didier Eribon, dans son dernier essai, évoque cet horizon que je pointe et qui se fait jour face à l'orientation que prend le mot de Culture dans nos sociétés néo-libérales. Il parle de la Culture comme d'une ruse suprême de la Domination. Une ruse qui impose sa faconde et son style. Le bon goût... Condition même de la culture, cette arme qui ne se définitit que dans le périmètre étroit édicté par la classe dominante. Il en parle comme d'une ruse imparable qui opère avec la complicité de ses cooptés, rejetant tout ce qui pourrait troubler son ordre esthétique, sélectionnant les oeuvres qu'il convient d'admirer dans les termes qui définissent son convenable en demeurant à tout jamais étrangers à toute vraie contestation artisitique. Didier Eribon rappelle Nizan, cette voix forte, réellement forte quand nombre d'artistes d'aujourd'hui ne font qu'y prétendent. La Bourgeoisie, affirmait Nizan, ne coïncide pas avec l'humain. Il nous faut, contre elle, inventer une autre manière d'être humain, une autre culture donc, construire des "temporalités inattendues". Et puisque nous écrivons encore dans la langue de l'ennemi, nous poser la question de savoir ce que cela change d'écrire dans sa langue notre radicale opposition à ce qui la fonde.
Didier Eribon, dans son dernier essai, évoque cet horizon que je pointe et qui se fait jour face à l'orientation que prend le mot de Culture dans nos sociétés néo-libérales. Il parle de la Culture comme d'une ruse suprême de la Domination. Une ruse qui impose sa faconde et son style. Le bon goût... Condition même de la culture, cette arme qui ne se définitit que dans le périmètre étroit édicté par la classe dominante. Il en parle comme d'une ruse imparable qui opère avec la complicité de ses cooptés, rejetant tout ce qui pourrait troubler son ordre esthétique, sélectionnant les oeuvres qu'il convient d'admirer dans les termes qui définissent son convenable en demeurant à tout jamais étrangers à toute vraie contestation artisitique. Didier Eribon rappelle Nizan, cette voix forte, réellement forte quand nombre d'artistes d'aujourd'hui ne font qu'y prétendent. La Bourgeoisie, affirmait Nizan, ne coïncide pas avec l'humain. Il nous faut, contre elle, inventer une autre manière d'être humain, une autre culture donc, construire des "temporalités inattendues". Et puisque nous écrivons encore dans la langue de l'ennemi, nous poser la question de savoir ce que cela change d'écrire dans sa langue notre radicale opposition à ce qui la fonde. Il y a donc un "travail de la culture" à faire face à cette survivance inavouée du nazisme, qui pointe déjà la faillitte d'une nation, la nôtre. L
Il y a donc un "travail de la culture" à faire face à cette survivance inavouée du nazisme, qui pointe déjà la faillitte d'une nation, la nôtre. L On aura vu la Gauche se payer cette fois encore de vains mots dans l'oubli du sens profond de cette phrase : le défaut de secours que l'on voit se faire jour en France à l'égard des plus démunis, à l'égard des classes populaires, à l'égard des petits-enfants d'immigrés, à l'égard des précaires, à l'égard des salariés pauvres, à l'égard des retraités pauvres, à l'égard des enseignants démonétisés, des enseignés méprisés, etc., l'on pourrait démultiplier à l'infini, est la cause de ce Mal qui finira bientôt par révéler son nom sinistre.
On aura vu la Gauche se payer cette fois encore de vains mots dans l'oubli du sens profond de cette phrase : le défaut de secours que l'on voit se faire jour en France à l'égard des plus démunis, à l'égard des classes populaires, à l'égard des petits-enfants d'immigrés, à l'égard des précaires, à l'égard des salariés pauvres, à l'égard des retraités pauvres, à l'égard des enseignants démonétisés, des enseignés méprisés, etc., l'on pourrait démultiplier à l'infini, est la cause de ce Mal qui finira bientôt par révéler son nom sinistre. Une vie à Gauche… Mais attention : cette vraie New Left américaine, pas cette fausse droite française affublée d’un gros nez rose, qui vit sans conviction intellectuelle ni morale.
Une vie à Gauche… Mais attention : cette vraie New Left américaine, pas cette fausse droite française affublée d’un gros nez rose, qui vit sans conviction intellectuelle ni morale.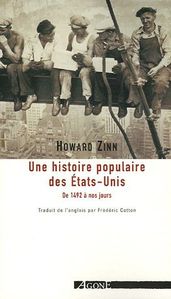 A 27 ans il reprend donc ses études, bénéficiant d’un programme de gratuité pour service rendu à la patrie. Il soutient son doctorat à la Columbia Université, postule à Atlanta, au Spelman College qui n’accueille derrière ses barbelés que des jeunes filles noires, s’engage aussitôt dans la lutte pour la reconnaissance des droits civiques des noirs. Au passage, Martin Duberman nous livre une superbe étude des positions des intellectuels de l’époque sur la question noire, dont celle de Faulkner, qui ne trouvait rien à redire à cette ségrégation pourvu que l’état fédéral acceptât de mieux financer les universités noires qui, en effet, ne percevaient que 0,66% de la manne dévolue aux universités américaines... Ou Schlesinger, condamnant le "dogmatisme" des militants noirs, trop pressés (!) à ses yeux de recouvrer leurs droits et à qui il recommandait davantage de patience…
A 27 ans il reprend donc ses études, bénéficiant d’un programme de gratuité pour service rendu à la patrie. Il soutient son doctorat à la Columbia Université, postule à Atlanta, au Spelman College qui n’accueille derrière ses barbelés que des jeunes filles noires, s’engage aussitôt dans la lutte pour la reconnaissance des droits civiques des noirs. Au passage, Martin Duberman nous livre une superbe étude des positions des intellectuels de l’époque sur la question noire, dont celle de Faulkner, qui ne trouvait rien à redire à cette ségrégation pourvu que l’état fédéral acceptât de mieux financer les universités noires qui, en effet, ne percevaient que 0,66% de la manne dévolue aux universités américaines... Ou Schlesinger, condamnant le "dogmatisme" des militants noirs, trop pressés (!) à ses yeux de recouvrer leurs droits et à qui il recommandait davantage de patience… Serge Tisseron évoque son psychanalyste, Didier Anzieu, à qui un jour lui prit l’envie de parler en cours de séance, s’étonnant de ce qu’il lui répondit si volontiers, rompant avec la sacro-sainte loi de distance, de neutralité, pour peu à peu tisser avec son patient quelque chose comme un espace de symbolisation partagée.
Serge Tisseron évoque son psychanalyste, Didier Anzieu, à qui un jour lui prit l’envie de parler en cours de séance, s’étonnant de ce qu’il lui répondit si volontiers, rompant avec la sacro-sainte loi de distance, de neutralité, pour peu à peu tisser avec son patient quelque chose comme un espace de symbolisation partagée. L’idée que tout ce qui diffère dérange est une simplification naïve, affirme Yves Barel. Car il existe des marginalités compatibles avec l’ordre social en place (celle des extrémistes de droite par exemple), et des révoltes qui ne le détruisent pas et ne font que changer les hommes porteurs de cet ordre social -voyez aussi la "génération 68".
L’idée que tout ce qui diffère dérange est une simplification naïve, affirme Yves Barel. Car il existe des marginalités compatibles avec l’ordre social en place (celle des extrémistes de droite par exemple), et des révoltes qui ne le détruisent pas et ne font que changer les hommes porteurs de cet ordre social -voyez aussi la "génération 68". Du représentant du Préfet au policier sur le terrain, en passant par les pilotes d’avion, l’escorte, les médecins qui établissent les certificats médicaux, Marie Cosnay a interrogé cette longue chaîne mutique du commandement d’expulsion, listant les tâches, les responsabilités et surtout, le degré de conscience des uns et des autres. Du tribunal au tarmac, on découvre une foule de gens et de métiers en charge des expulsions de personnes en situations irrégulières. Une chaîne où les responsabilités sont émiettées, tactiquement, rappelant fort les études des historiens sur le fonctionnement de l’administration française de Vichy en matière de traitement de la déportation, et dont l’efficacité fut louée par l’Administration nazie. Ad nauseam, le morcellement des tâches était déjà l’une des conditions de l’efficacité du système. Cela permettait d’isoler les uns des autres les acteurs de cette servitude, les enfermant chacun dans des tâches routinières et aveugles quant à la réalité de leurs effets, leur loyauté et leur conscience professionnelle faisant le reste…
Du représentant du Préfet au policier sur le terrain, en passant par les pilotes d’avion, l’escorte, les médecins qui établissent les certificats médicaux, Marie Cosnay a interrogé cette longue chaîne mutique du commandement d’expulsion, listant les tâches, les responsabilités et surtout, le degré de conscience des uns et des autres. Du tribunal au tarmac, on découvre une foule de gens et de métiers en charge des expulsions de personnes en situations irrégulières. Une chaîne où les responsabilités sont émiettées, tactiquement, rappelant fort les études des historiens sur le fonctionnement de l’administration française de Vichy en matière de traitement de la déportation, et dont l’efficacité fut louée par l’Administration nazie. Ad nauseam, le morcellement des tâches était déjà l’une des conditions de l’efficacité du système. Cela permettait d’isoler les uns des autres les acteurs de cette servitude, les enfermant chacun dans des tâches routinières et aveugles quant à la réalité de leurs effets, leur loyauté et leur conscience professionnelle faisant le reste…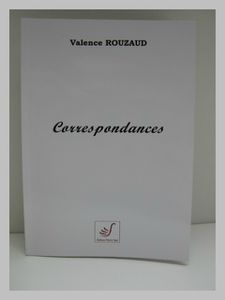 Cinquante-huit lettres comme autant de bouteilles jetées à la mer. J’ignore tout de Valence Rouzaud. J’ignore même s’il existe ou s’il a existé réellement. Passager clandestin d’un siècle débordé. Le monde ne serait plus un bateau ivre, regrette-t-il, à peine quelque cargo commissionnaire.
Cinquante-huit lettres comme autant de bouteilles jetées à la mer. J’ignore tout de Valence Rouzaud. J’ignore même s’il existe ou s’il a existé réellement. Passager clandestin d’un siècle débordé. Le monde ne serait plus un bateau ivre, regrette-t-il, à peine quelque cargo commissionnaire.
 A l’heure où de sinistres ligues sont lâchées dans les rues, où le retour de l’extrémisme assassin s’accomplit au grand jour, où l’ambiance délétère de la société française, pleine d’effroi pour ce Dernier Virage à Droite qui la tente tellement désormais, éclate au grand jour, il y a tout à la fois quelque chose comme une sourde angoisse qui perce de cet essai de Didier Eribon, et l’espoir, immense, que nous avons peut-être la maturité de ne pas nous laisser enfermer dans les plis nauséeux d’on ne sait quelles annales typiquement françaises.
A l’heure où de sinistres ligues sont lâchées dans les rues, où le retour de l’extrémisme assassin s’accomplit au grand jour, où l’ambiance délétère de la société française, pleine d’effroi pour ce Dernier Virage à Droite qui la tente tellement désormais, éclate au grand jour, il y a tout à la fois quelque chose comme une sourde angoisse qui perce de cet essai de Didier Eribon, et l’espoir, immense, que nous avons peut-être la maturité de ne pas nous laisser enfermer dans les plis nauséeux d’on ne sait quelles annales typiquement françaises.